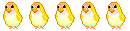Lodie le vent en poupe ( y net !!!!!
Modérateurs : Modérateurs, Membres actifs
Règles du forum
Merci de prendre connaissance de la Netiquette d'Enfine avant toute consultation ou utilisation.
Merci de prendre connaissance de la Netiquette d'Enfine avant toute consultation ou utilisation.
- Sab
- Sab'liées et Tite Grande Sab... ;-)
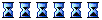
- Messages : 4646
- Enregistré le : 14 mars 2003, 01:00
- Localisation : planète lol
moi ça marche pas. tu as dû connaitre ce stress l'année dernière. L'autre jour en cours il y avait une fille avec une trousse Ben,c'etait pour ça le texto, en cours je griffonne; au début j'ai cru que c'etait par ennui mais je rends compte que ça me le fait aussi lorsque je me retiens de pleurer. Heureusement ,parfois y'a des gens qui se chapeautent en cocotte minute. Y'a ma pote de l'iufm,elle est bizarre en ce moment. Puis on n'a plus trop le temps de discuter désormais. J'ai l'impression d'être une "machine à lire". Tous les soirs je rentre chez moi en ayant des kilos de polycopiés;ma prof est une tueuse d'arbres invétérée. Je les lis tous au fur et à mesure sinon c'est même pas la ^peine.Puis j'ai moi je n'ai même plus la place pour les mettre. Le 3 dec je dois cartonner pour mon exposé ^parce que je sais que Ginette m'attend au tournant. Je deviens un rat de bibliothèque. Je suis dans l'incertitude la plus totale,ayant autant peur de l'échec que de la réussite.En rentrant le soir je me rends compte à quel point...c'est peut-être même pas la peine que je fasse tout ça. Turlututu chapeau pointu
gros bisous
gros bisous
- Elodie
- Modératrice trash

- Messages : 2605
- Enregistré le : 28 mars 2003, 01:00
- Localisation : Au boulot !
Ma Sabbou,
oui, je le connais ce stress. Toute une année à bûcher et tout jouer en quelques dizaines de minutes... Argh !
Et bizarrement, depuis que je bosse, je regrette mes années d'étudiante. Je me dis que c'est surement parce que je n'ai pas trouvé le bon boulot.
J'ai quitté IDEM, le magasin de déco, parce que ça ne se passait pas bien et que j'avais une autre proposition : enquêtrice vacataire dans une petite boite de marketing. Je bosse une semaine par ci et une semaine par là mais je ne parviens à atteindre le SMIC donc c'est pas glorieux. Le bon côté, c'est que c'est dans ma branche (si on veut...). Mais les choses semblent un peu avancer et j'espère avoir quelques entretiens prochainement.
Je compatis ma belle, je t'embrasse,
Elodie.
oui, je le connais ce stress. Toute une année à bûcher et tout jouer en quelques dizaines de minutes... Argh !
Et bizarrement, depuis que je bosse, je regrette mes années d'étudiante. Je me dis que c'est surement parce que je n'ai pas trouvé le bon boulot.
J'ai quitté IDEM, le magasin de déco, parce que ça ne se passait pas bien et que j'avais une autre proposition : enquêtrice vacataire dans une petite boite de marketing. Je bosse une semaine par ci et une semaine par là mais je ne parviens à atteindre le SMIC donc c'est pas glorieux. Le bon côté, c'est que c'est dans ma branche (si on veut...). Mais les choses semblent un peu avancer et j'espère avoir quelques entretiens prochainement.
Je compatis ma belle, je t'embrasse,
Elodie.
- Elodie
- Modératrice trash

- Messages : 2605
- Enregistré le : 28 mars 2003, 01:00
- Localisation : Au boulot !
Merci les filles !!! :)
Pour la blague... j'avais pris l'habitude de mettre les pubs qui m'intéressaient pas dans la boite aux lettres de madame cheutron et l'autre jour, devinez quoi ?! Plus le même nom sur sa boite !!! Elle a du déménager !!! L'aurai-je fait fuir ???
En espérant vous avoir fait sourire comme vous m'avez fait sourire avec vos messages,
je vous embrasse,
Elo, qui transmet à son amoureux ;-)
Pour la blague... j'avais pris l'habitude de mettre les pubs qui m'intéressaient pas dans la boite aux lettres de madame cheutron et l'autre jour, devinez quoi ?! Plus le même nom sur sa boite !!! Elle a du déménager !!! L'aurai-je fait fuir ???
En espérant vous avoir fait sourire comme vous m'avez fait sourire avec vos messages,
je vous embrasse,
Elo, qui transmet à son amoureux ;-)
- Sab
- Sab'liées et Tite Grande Sab... ;-)
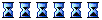
- Messages : 4646
- Enregistré le : 14 mars 2003, 01:00
- Localisation : planète lol
Lodie j'ai besoin de ton aide!
tu connais cet article paru dans un Sciences Humaines d'octobre 2004 :
"Les politiques éducatives entre le dire et le faire "
Par AGNÈS VAN ZANTEN
c'est un truc hyper chiant, et, en gros ça parle de marchandisation, globalisation, décentralisation, c'est ça?
je ne comprends pas ce que je suis sensée comprendre là dedans.
puis j'ai une question : décentralisation/ mondialisation... c'est pas deux choses un peu opposées? vu que l'un standardise les pratiques, et que l'autre prend le risque de les rendre + hétérogènes...
tu connais cet article paru dans un Sciences Humaines d'octobre 2004 :
"Les politiques éducatives entre le dire et le faire "
Par AGNÈS VAN ZANTEN
c'est un truc hyper chiant, et, en gros ça parle de marchandisation, globalisation, décentralisation, c'est ça?
je ne comprends pas ce que je suis sensée comprendre là dedans.
puis j'ai une question : décentralisation/ mondialisation... c'est pas deux choses un peu opposées? vu que l'un standardise les pratiques, et que l'autre prend le risque de les rendre + hétérogènes...
- Elodie
- Modératrice trash

- Messages : 2605
- Enregistré le : 28 mars 2003, 01:00
- Localisation : Au boulot !
Bon, t'as de la chance, Agnès était l'une de mes profs en DEA !!!
Je ne crois pas avoir lu cet article -ou alors, je m'en souviens pas, ce qui est possible aussi !!!
Bon, une seconde, je regarde mes cours...
...
Ah, voilà !!! Une chance que je range tout !
Donc, avec Agnès, le cours portait essentiellement sur la ségrégation scolaire. Je pense qu'on n'est pas loin de ton article...
Il existe 2 indicateurs pour mesurer la ségrégation scolaire :
- l'indice de dissimilarités, c'est à dire l'écart entre 2 groupes
- l'indice de concentration, c'est à dire le rapport du gpe à la population
Autrefois, il existait une séparation institutionnelle des populations, auj., le syst. s'est uniformisé ms la ségrégation repose sur des diff. qualitatives entre établissements (liées à la pop. accueillie et à l'implantation géographique).
Le truc, c'est que tu as deux phénomènes parallèles :
la délocalisation des activités d'une part et la concentration de la pop. d'autre part.
Du coup, et pour résumé, la situation s'aggrave.
Au niveau des politiques éducatives :
-> territorialisation des politiques éduc. : lancées au niveau national mais ds un rapport nouveau école-territoire (exple des ZEP)
Partenariats entre l'éduc. nationale et les politiques de la ville, de la culture...
-> déconcentration de l'éduc. nationale : il y a 2 niveaux territoriaux importts qui sont les rectorats et les inspections académiques. On note une délégation des compétences au nom de l'état.
-> décentralisation éducative
En gros, universités gérées par l'état, lycées par la région, collèges par le dptt, et le primaire par la commune.
C'est théorique pcq ds la réalité, ça marche pas aussi bien !
Evolution globale ds la conduite des politiques
- depuis plsrs années, efforts de modernisation des services publics et intérêt grandissant pour l'action publique.
- la politique d'éduc. est peu transparente (consensus état-enseignants). Les sujets d'éduc. ne sont pas débattus au parlement.
- modernisation des services publics (cf Rocard)
- incapacité à réguler les pb de ségrégation (pas de projets en matière d'égalité des chances ou d'encadrement idéologique). Du coup, l'institution dvppe un discours éthique + que politique.
Politique des cartes scolaires (1963)
la gestion de cette politique alterne entre laxisme et autoritarisme :
- milieu des 80's : Savary lance une politique d'assouplissement de la carte scolaire (choix entre 3 ou 5 lycées). Cette politique est gérée au niveau local et peut devenir facteur de ségrégation (car appliquée de manière très bureaucratique, sans reflexion !)
- 90's : gestion tolérante des demandes de dérogation
- fin des 90's : autoritarisme qui entraîne une hausse du phénomène des déménagements et renforce la dimension instrumentale des options (par exple : prendre russe car seul tel lycée le propose, tu vois ?)
Actions des collectivités territoriales
les municipalités s'investissent de + en + ds la péda ou l'équipement informatique.
Donc ça créé des diff. entre les municipalités riches et pauvres, entre celles qui font de la scolarité une priorité et les autres...
Bon ben voilà...
J'espère que ces quelques infos pourront te servir à mieux comprendre ton texte.
Si ce que j'ai écrit n'est pas clair, hésite pas à me demander...
Je t'embrasse.
Elo.
Je ne crois pas avoir lu cet article -ou alors, je m'en souviens pas, ce qui est possible aussi !!!
Bon, une seconde, je regarde mes cours...
...
Ah, voilà !!! Une chance que je range tout !
Donc, avec Agnès, le cours portait essentiellement sur la ségrégation scolaire. Je pense qu'on n'est pas loin de ton article...
Il existe 2 indicateurs pour mesurer la ségrégation scolaire :
- l'indice de dissimilarités, c'est à dire l'écart entre 2 groupes
- l'indice de concentration, c'est à dire le rapport du gpe à la population
Autrefois, il existait une séparation institutionnelle des populations, auj., le syst. s'est uniformisé ms la ségrégation repose sur des diff. qualitatives entre établissements (liées à la pop. accueillie et à l'implantation géographique).
Le truc, c'est que tu as deux phénomènes parallèles :
la délocalisation des activités d'une part et la concentration de la pop. d'autre part.
Du coup, et pour résumé, la situation s'aggrave.
Au niveau des politiques éducatives :
-> territorialisation des politiques éduc. : lancées au niveau national mais ds un rapport nouveau école-territoire (exple des ZEP)
Partenariats entre l'éduc. nationale et les politiques de la ville, de la culture...
-> déconcentration de l'éduc. nationale : il y a 2 niveaux territoriaux importts qui sont les rectorats et les inspections académiques. On note une délégation des compétences au nom de l'état.
-> décentralisation éducative
En gros, universités gérées par l'état, lycées par la région, collèges par le dptt, et le primaire par la commune.
C'est théorique pcq ds la réalité, ça marche pas aussi bien !
Evolution globale ds la conduite des politiques
- depuis plsrs années, efforts de modernisation des services publics et intérêt grandissant pour l'action publique.
- la politique d'éduc. est peu transparente (consensus état-enseignants). Les sujets d'éduc. ne sont pas débattus au parlement.
- modernisation des services publics (cf Rocard)
- incapacité à réguler les pb de ségrégation (pas de projets en matière d'égalité des chances ou d'encadrement idéologique). Du coup, l'institution dvppe un discours éthique + que politique.
Politique des cartes scolaires (1963)
la gestion de cette politique alterne entre laxisme et autoritarisme :
- milieu des 80's : Savary lance une politique d'assouplissement de la carte scolaire (choix entre 3 ou 5 lycées). Cette politique est gérée au niveau local et peut devenir facteur de ségrégation (car appliquée de manière très bureaucratique, sans reflexion !)
- 90's : gestion tolérante des demandes de dérogation
- fin des 90's : autoritarisme qui entraîne une hausse du phénomène des déménagements et renforce la dimension instrumentale des options (par exple : prendre russe car seul tel lycée le propose, tu vois ?)
Actions des collectivités territoriales
les municipalités s'investissent de + en + ds la péda ou l'équipement informatique.
Donc ça créé des diff. entre les municipalités riches et pauvres, entre celles qui font de la scolarité une priorité et les autres...
Bon ben voilà...
J'espère que ces quelques infos pourront te servir à mieux comprendre ton texte.
Si ce que j'ai écrit n'est pas clair, hésite pas à me demander...
Je t'embrasse.
Elo.
- Sab
- Sab'liées et Tite Grande Sab... ;-)
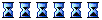
- Messages : 4646
- Enregistré le : 14 mars 2003, 01:00
- Localisation : planète lol
merci d'avoir pris le temps de recopier ton cours pour moi 
Je comprends tout ce qui est carte scolaire, inégalités, mais l'article parle beaucoup du décalage entre les décisions politiques et la façon dont elles sont rééllement appliquées...
voici un extrait du texte d'AVZ que je n'ai pas compris:
"Un jeu d'acteurs opaque et complexe
en plus d'influer sur la définition des finalités de l'école, les grands acteurs du système éducatif - les hommes politiques, les syndicats enseignants, les experts, le presonnel de l'administration - jouent un rôle fondamental dans les prises de décisions politiques et leurs applications. Il existe néanmoins à leur sujet un certain nombre d'idées reçues qu'il est inutile de déconstruire. (bon,ça ça va)
La première concerne la vision largement partagée de l'originalité du lien entre l'école et l'Etat central en France. Tout d'abord cette "exception française" est très relative. Un modèle transnational d' "école de masse" s'est en effet diffusé dans les sociétés occidentales avancées au cours du XIXe siècle par des processus de mimétisme institutionnel, puis dans le reste du monde avec la colonisation et le développement ultérieur des Etats-nations(là j'pige pas: c'est quoi du mimétisme instiutionnel c'est les différentes institutions européennes qui se sont imitées les unes les autres? c'est quoi les Etats-Nation? je l'avais vu en fac mais je ne me souviens plus ce que c'est). Cette vision conduit par ailleurs à minimiser les convergences récentes entre les systèmes éducatifs engendrées par les évolutions de l'économie, la circulation plus importante et plus rapide des idées et l'impulsion d'acteurs transnationaux. L'Union Européenne, par exemple, oriente les politiques nationales à travers l'élargissement du concept de formation professionnelle ou des décisions concernant la mobilité des étudiants et la reconnaissance des diplômes. Ce qui n'exclut pas le maintien de spécificités nationales, comme on l'a vu avec la question du libre choix de l'école. bon; en gros elle dit que ça se mondialise mais qu'avec la décentralisation les décisions locales sont loin d'être exclues ou quelque chose comme ça?
Une autre idée reçue concerne la place centrale, voire hégémonique, qu'occuperait la négociation entre l'Etat et les syndicats enseignants dans l'élaboration des politiques. Certes, ces derniers orientent encore fortement les choix et leurs modalités d'application : ils interviennent dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques aussi bien par la cntestation que par les échanges avec les dirigeants au niveau central et la participation au niveau local, notemment à la gestion des carrières. Toutefois, ces trois modes d'intervention ne sont plus aussi efficaces qu'auparavant. Les actions revendicatrices de la base sont moins controlées qu'autrefois par les dirigeants, la négociation est critiquée pour son absence de transparence (c'est ce que tu me disais tout à l'heure) et, surtout, le faible poids politique des syndicats dans les instances de concertation - -comme les conseils académiques ou départementaux - limite fortement leur influence, plus encore dans le cadre de la décentralisation.
L'influence des syndicats enseignants se trouve aussi affaiblie par le recours aux experts scientifiques et aux nombreuses instances consultatives, qu'elles soient permanentes ( comme le Conseil National des Programmes) ou temporaires, (comme les nombreuses commissions créées à l'occasion de telle ou telle réforme). L'Etat y fait appel afin de se doter d'une plus grande expertise technique et d'une plus forte légitimité politique.ce paragraphe signifie-t-il que les principaux acteurs de terrain(les enseignants) sont de moins en moins consultés?
L'autonomie du système éducatif s'est en outre réduite depuis les années 60 par le développement de liens plus étroits entre les planifications économique et éducative. L'influence croissante de l'économie s'est exercée d'abord de façon centralisée, au travers des plans du Commissariat général du plan kesako?.Actuellement, elle est moins dirigiste et plus localisée. Cela est particulièrement évident dans l'enseignement professionnel au sein duquel on tente d'ajuster la formation à l'emploi au niveau national : dans les commissions professionnelles consultatives, et aux niveaux régional et départemental, dans les bassins de la formation à l'emploi. Enfin, l'autonomie du champ éducatif se trouve également limitée par l'articulation des politiques d'éducation avec d'autres politiques sectorielles, comme par exemple celle de la ville (ça tu le disais aussi tout à l'heure.Mais en quoi est-ce un mal?)
Un dernier préjugé très répandu concerne le fonctionnement de l'administartion de l'éducation nationale, souvent critiquée pour son haut degré de centralisation et son immobilisme bureaucratique. Il est vrai que, malgré la décentralisation, l'administration centrale conserve encore des compétences essentielles et des moyens divers d'influence sur les décisions locales. Par ailleurs, la "centrale" et plus encore les administrations locales peuvent apparaître comme le modèle le plus achevé de la bureaucratie à la française : omniprésence de la hiérarchie, haut degré de segmentation des directions, des services et des tâches, et forte standardisation des activités(j'comprends rien du tout là). Mais un certain nombre de changements apparaissent. Le découplage entre l'action de l'administration et le coeur de l'activité qu'elle est censée encadrer -c'est à dire l'action pédagogique dans les classes- semble diminuer. Le système tend, en fait, à "pédagogiser" la hierarchie administrative et à demander à la hiérarchie pédagogique d'intégrer les dimensions administratives et financières


 . Ainsi, l'Inspection Générale de l'Education Nationale joue un rôle plus important qu'autrefois de conseil et d'aide à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique éducative au niveau national (réformes, formations, programmes et méthodes d'enseignement) mais aussi au niveau territorial (analyse du fonctionnement des académies)."
. Ainsi, l'Inspection Générale de l'Education Nationale joue un rôle plus important qu'autrefois de conseil et d'aide à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique éducative au niveau national (réformes, formations, programmes et méthodes d'enseignement) mais aussi au niveau territorial (analyse du fonctionnement des académies)."
je dois vraiment être bête ou c'est normal que j'y pige presque rien?
Je comprends tout ce qui est carte scolaire, inégalités, mais l'article parle beaucoup du décalage entre les décisions politiques et la façon dont elles sont rééllement appliquées...
Tu veux dire que l'Etat délègue ses missions aux rectorats et aux IA ? ou le contraire?Lodie a écrit : -> déconcentration de l'éduc. nationale : il y a 2 niveaux territoriaux importts qui sont les rectorats et les inspections académiques. On note une délégation des compétences au nom de l'état.
voici un extrait du texte d'AVZ que je n'ai pas compris:
"Un jeu d'acteurs opaque et complexe
en plus d'influer sur la définition des finalités de l'école, les grands acteurs du système éducatif - les hommes politiques, les syndicats enseignants, les experts, le presonnel de l'administration - jouent un rôle fondamental dans les prises de décisions politiques et leurs applications. Il existe néanmoins à leur sujet un certain nombre d'idées reçues qu'il est inutile de déconstruire. (bon,ça ça va)
La première concerne la vision largement partagée de l'originalité du lien entre l'école et l'Etat central en France. Tout d'abord cette "exception française" est très relative. Un modèle transnational d' "école de masse" s'est en effet diffusé dans les sociétés occidentales avancées au cours du XIXe siècle par des processus de mimétisme institutionnel, puis dans le reste du monde avec la colonisation et le développement ultérieur des Etats-nations(là j'pige pas: c'est quoi du mimétisme instiutionnel c'est les différentes institutions européennes qui se sont imitées les unes les autres? c'est quoi les Etats-Nation? je l'avais vu en fac mais je ne me souviens plus ce que c'est). Cette vision conduit par ailleurs à minimiser les convergences récentes entre les systèmes éducatifs engendrées par les évolutions de l'économie, la circulation plus importante et plus rapide des idées et l'impulsion d'acteurs transnationaux. L'Union Européenne, par exemple, oriente les politiques nationales à travers l'élargissement du concept de formation professionnelle ou des décisions concernant la mobilité des étudiants et la reconnaissance des diplômes. Ce qui n'exclut pas le maintien de spécificités nationales, comme on l'a vu avec la question du libre choix de l'école. bon; en gros elle dit que ça se mondialise mais qu'avec la décentralisation les décisions locales sont loin d'être exclues ou quelque chose comme ça?
Une autre idée reçue concerne la place centrale, voire hégémonique, qu'occuperait la négociation entre l'Etat et les syndicats enseignants dans l'élaboration des politiques. Certes, ces derniers orientent encore fortement les choix et leurs modalités d'application : ils interviennent dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques aussi bien par la cntestation que par les échanges avec les dirigeants au niveau central et la participation au niveau local, notemment à la gestion des carrières. Toutefois, ces trois modes d'intervention ne sont plus aussi efficaces qu'auparavant. Les actions revendicatrices de la base sont moins controlées qu'autrefois par les dirigeants, la négociation est critiquée pour son absence de transparence (c'est ce que tu me disais tout à l'heure) et, surtout, le faible poids politique des syndicats dans les instances de concertation - -comme les conseils académiques ou départementaux - limite fortement leur influence, plus encore dans le cadre de la décentralisation.
L'influence des syndicats enseignants se trouve aussi affaiblie par le recours aux experts scientifiques et aux nombreuses instances consultatives, qu'elles soient permanentes ( comme le Conseil National des Programmes) ou temporaires, (comme les nombreuses commissions créées à l'occasion de telle ou telle réforme). L'Etat y fait appel afin de se doter d'une plus grande expertise technique et d'une plus forte légitimité politique.ce paragraphe signifie-t-il que les principaux acteurs de terrain(les enseignants) sont de moins en moins consultés?
L'autonomie du système éducatif s'est en outre réduite depuis les années 60 par le développement de liens plus étroits entre les planifications économique et éducative. L'influence croissante de l'économie s'est exercée d'abord de façon centralisée, au travers des plans du Commissariat général du plan kesako?.Actuellement, elle est moins dirigiste et plus localisée. Cela est particulièrement évident dans l'enseignement professionnel au sein duquel on tente d'ajuster la formation à l'emploi au niveau national : dans les commissions professionnelles consultatives, et aux niveaux régional et départemental, dans les bassins de la formation à l'emploi. Enfin, l'autonomie du champ éducatif se trouve également limitée par l'articulation des politiques d'éducation avec d'autres politiques sectorielles, comme par exemple celle de la ville (ça tu le disais aussi tout à l'heure.Mais en quoi est-ce un mal?)
Un dernier préjugé très répandu concerne le fonctionnement de l'administartion de l'éducation nationale, souvent critiquée pour son haut degré de centralisation et son immobilisme bureaucratique. Il est vrai que, malgré la décentralisation, l'administration centrale conserve encore des compétences essentielles et des moyens divers d'influence sur les décisions locales. Par ailleurs, la "centrale" et plus encore les administrations locales peuvent apparaître comme le modèle le plus achevé de la bureaucratie à la française : omniprésence de la hiérarchie, haut degré de segmentation des directions, des services et des tâches, et forte standardisation des activités(j'comprends rien du tout là). Mais un certain nombre de changements apparaissent. Le découplage entre l'action de l'administration et le coeur de l'activité qu'elle est censée encadrer -c'est à dire l'action pédagogique dans les classes- semble diminuer. Le système tend, en fait, à "pédagogiser" la hierarchie administrative et à demander à la hiérarchie pédagogique d'intégrer les dimensions administratives et financières
je dois vraiment être bête ou c'est normal que j'y pige presque rien?
- Elodie
- Modératrice trash

- Messages : 2605
- Enregistré le : 28 mars 2003, 01:00
- Localisation : Au boulot !
"Un jeu d'acteurs opaque et complexe
en plus d'influer sur la définition des finalités de l'école, les grands acteurs du système éducatif - les hommes politiques, les syndicats enseignants, les experts, le presonnel de l'administration - jouent un rôle fondamental dans les prises de décisions politiques et leurs applications. Il existe néanmoins à leur sujet un certain nombre d'idées reçues qu'il est inutile de déconstruire. (bon,ça ça va)
La première concerne la vision largement partagée de l'originalité du lien entre l'école et l'Etat central en France. Tout d'abord cette "exception française" est très relative. Un modèle transnational d' "école de masse" s'est en effet diffusé dans les sociétés occidentales avancées au cours du XIXe siècle par des processus de mimétisme institutionnel, puis dans le reste du monde avec la colonisation et le développement ultérieur des Etats-nations(là j'pige pas: c'est quoi du mimétisme instiutionnel c'est les différentes institutions européennes qui se sont imitées les unes les autres? c'est quoi les Etats-Nation? je l'avais vu en fac mais je ne me souviens plus ce que c'est).
T'as tout compris, en effet, chaque état s'est plus ou moins copié, prenant ce qu'il trouvait de plus intéressant chez leurs voisins. Du coup, le système éducatif européen reste assez homogène, c'est pourquoi elle relativise la pseudo "exception française".
Pour état-nation, c'est quand l'état et la nation se superpose parce qu'il y a correspondance. T'arrêtes pas là dessus, ça n'a pas gde importance !
Cette vision conduit par ailleurs à minimiser les convergences récentes entre les systèmes éducatifs engendrées par les évolutions de l'économie, la circulation plus importante et plus rapide des idées et l'impulsion d'acteurs transnationaux. L'Union Européenne, par exemple, oriente les politiques nationales à travers l'élargissement du concept de formation professionnelle ou des décisions concernant la mobilité des étudiants et la reconnaissance des diplômes. Ce qui n'exclut pas le maintien de spécificités nationales, comme on l'a vu avec la question du libre choix de l'école. bon; en gros elle dit que ça se mondialise mais qu'avec la décentralisation les décisions locales sont loin d'être exclues ou quelque chose comme ça?
C'est ça. Elle dit que malgré les tentatives d'uniformisation des systèmes éducatifs européens, il reste des particularismes locaux
Une autre idée reçue concerne la place centrale, voire hégémonique, qu'occuperait la négociation entre l'Etat et les syndicats enseignants dans l'élaboration des politiques. Certes, ces derniers orientent encore fortement les choix et leurs modalités d'application : ils interviennent dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques aussi bien par la cntestation que par les échanges avec les dirigeants au niveau central et la participation au niveau local, notemment à la gestion des carrières. Toutefois, ces trois modes d'intervention ne sont plus aussi efficaces qu'auparavant. Les actions revendicatrices de la base sont moins controlées qu'autrefois par les dirigeants, la négociation est critiquée pour son absence de transparence (c'est ce que tu me disais tout à l'heure) et, surtout, le faible poids politique des syndicats dans les instances de concertation - -comme les conseils académiques ou départementaux - limite fortement leur influence, plus encore dans le cadre de la décentralisation.
L'influence des syndicats enseignants se trouve aussi affaiblie par le recours aux experts scientifiques et aux nombreuses instances consultatives, qu'elles soient permanentes ( comme le Conseil National des Programmes) ou temporaires, (comme les nombreuses commissions créées à l'occasion de telle ou telle réforme). L'Etat y fait appel afin de se doter d'une plus grande expertise technique et d'une plus forte légitimité politique.ce paragraphe signifie-t-il que les principaux acteurs de terrain(les enseignants) sont de moins en moins consultés?
Oui, leur poids est de moins en moins important. L'état s'offre une légitimité en créant des conseils mais cela ne sert à rien puisqu'ils n'ont que très peu de pouvoir.
L'autonomie du système éducatif s'est en outre réduite depuis les années 60 par le développement de liens plus étroits entre les planifications économique et éducative. L'influence croissante de l'économie s'est exercée d'abord de façon centralisée, au travers des plans du Commissariat général du plan kesako?.
Le plan, c'est une sorte de document qui présente les grandes orientations économiques et sociales à venir. Il est réalisé par l'état en concertation avec les différents partenaires sociaux (syndicats, associations, etc...). Tu vois le lien ?
Actuellement, elle est moins dirigiste et plus localisée. Cela est particulièrement évident dans l'enseignement professionnel au sein duquel on tente d'ajuster la formation à l'emploi au niveau national : dans les commissions professionnelles consultatives, et aux niveaux régional et départemental, dans les bassins de la formation à l'emploi. Enfin, l'autonomie du champ éducatif se trouve également limitée par l'articulation des politiques d'éducation avec d'autres politiques sectorielles, comme par exemple celle de la ville (ça tu le disais aussi tout à l'heure.Mais en quoi est-ce un mal?)
Ben en fait, les villes ont plus ou moins de moyens et le budget consacré à la scolarité peut être très variable d'une ville à l'autre...
Un dernier préjugé très répandu concerne le fonctionnement de l'administartion de l'éducation nationale, souvent critiquée pour son haut degré de centralisation et son immobilisme bureaucratique. Il est vrai que, malgré la décentralisation, l'administration centrale conserve encore des compétences essentielles et des moyens divers d'influence sur les décisions locales. Par ailleurs, la "centrale" et plus encore les administrations locales peuvent apparaître comme le modèle le plus achevé de la bureaucratie à la française : omniprésence de la hiérarchie, haut degré de segmentation des directions, des services et des tâches, et forte standardisation des activités(j'comprends rien du tout là).
Tu t'en fous, c'est une description à la AVZ comme seule elle peut en faire...
Mais un certain nombre de changements apparaissent. Le découplage entre l'action de l'administration et le coeur de l'activité qu'elle est censée encadrer -c'est à dire l'action pédagogique dans les classes- semble diminuer. Le système tend, en fait, à "pédagogiser" la hierarchie administrative et à demander à la hiérarchie pédagogique d'intégrer les dimensions administratives et financières


 . Ainsi, l'Inspection Générale de l'Education Nationale joue un rôle plus important qu'autrefois de conseil et d'aide à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique éducative au niveau national (réformes, formations, programmes et méthodes d'enseignement) mais aussi au niveau territorial (analyse du fonctionnement des académies)."
. Ainsi, l'Inspection Générale de l'Education Nationale joue un rôle plus important qu'autrefois de conseil et d'aide à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique éducative au niveau national (réformes, formations, programmes et méthodes d'enseignement) mais aussi au niveau territorial (analyse du fonctionnement des académies)."
je dois vraiment être bête ou c'est normal que j'y pige presque rien?[/quote]
Non, les sociologues ont la mauvaise habitude de faire des phrases complexes pour des trucs tout con, ça leur donne un air intelligent !!!
Bref, lis les remarques que je t'ai mise puis lâche ton texte un moment et reviens y plus tard à tête reposée.
Je vais faire mon sac, je pars à Troyes avec Juju et ne reviens que dimanche soir mais si t'as le moindre souci de compréhension, tu peux m'appeler sur mon portable et sinon, tu peux toujours envoyer un mail à AVZ pour qu'elle t'explicite ce qu'elle a voulu dire.
Voilà son adresse : agnes.vanzanten@sciences-po.fr
Bon courage,
Elo.
en plus d'influer sur la définition des finalités de l'école, les grands acteurs du système éducatif - les hommes politiques, les syndicats enseignants, les experts, le presonnel de l'administration - jouent un rôle fondamental dans les prises de décisions politiques et leurs applications. Il existe néanmoins à leur sujet un certain nombre d'idées reçues qu'il est inutile de déconstruire. (bon,ça ça va)
La première concerne la vision largement partagée de l'originalité du lien entre l'école et l'Etat central en France. Tout d'abord cette "exception française" est très relative. Un modèle transnational d' "école de masse" s'est en effet diffusé dans les sociétés occidentales avancées au cours du XIXe siècle par des processus de mimétisme institutionnel, puis dans le reste du monde avec la colonisation et le développement ultérieur des Etats-nations(là j'pige pas: c'est quoi du mimétisme instiutionnel c'est les différentes institutions européennes qui se sont imitées les unes les autres? c'est quoi les Etats-Nation? je l'avais vu en fac mais je ne me souviens plus ce que c'est).
T'as tout compris, en effet, chaque état s'est plus ou moins copié, prenant ce qu'il trouvait de plus intéressant chez leurs voisins. Du coup, le système éducatif européen reste assez homogène, c'est pourquoi elle relativise la pseudo "exception française".
Pour état-nation, c'est quand l'état et la nation se superpose parce qu'il y a correspondance. T'arrêtes pas là dessus, ça n'a pas gde importance !
Cette vision conduit par ailleurs à minimiser les convergences récentes entre les systèmes éducatifs engendrées par les évolutions de l'économie, la circulation plus importante et plus rapide des idées et l'impulsion d'acteurs transnationaux. L'Union Européenne, par exemple, oriente les politiques nationales à travers l'élargissement du concept de formation professionnelle ou des décisions concernant la mobilité des étudiants et la reconnaissance des diplômes. Ce qui n'exclut pas le maintien de spécificités nationales, comme on l'a vu avec la question du libre choix de l'école. bon; en gros elle dit que ça se mondialise mais qu'avec la décentralisation les décisions locales sont loin d'être exclues ou quelque chose comme ça?
C'est ça. Elle dit que malgré les tentatives d'uniformisation des systèmes éducatifs européens, il reste des particularismes locaux
Une autre idée reçue concerne la place centrale, voire hégémonique, qu'occuperait la négociation entre l'Etat et les syndicats enseignants dans l'élaboration des politiques. Certes, ces derniers orientent encore fortement les choix et leurs modalités d'application : ils interviennent dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques aussi bien par la cntestation que par les échanges avec les dirigeants au niveau central et la participation au niveau local, notemment à la gestion des carrières. Toutefois, ces trois modes d'intervention ne sont plus aussi efficaces qu'auparavant. Les actions revendicatrices de la base sont moins controlées qu'autrefois par les dirigeants, la négociation est critiquée pour son absence de transparence (c'est ce que tu me disais tout à l'heure) et, surtout, le faible poids politique des syndicats dans les instances de concertation - -comme les conseils académiques ou départementaux - limite fortement leur influence, plus encore dans le cadre de la décentralisation.
L'influence des syndicats enseignants se trouve aussi affaiblie par le recours aux experts scientifiques et aux nombreuses instances consultatives, qu'elles soient permanentes ( comme le Conseil National des Programmes) ou temporaires, (comme les nombreuses commissions créées à l'occasion de telle ou telle réforme). L'Etat y fait appel afin de se doter d'une plus grande expertise technique et d'une plus forte légitimité politique.ce paragraphe signifie-t-il que les principaux acteurs de terrain(les enseignants) sont de moins en moins consultés?
Oui, leur poids est de moins en moins important. L'état s'offre une légitimité en créant des conseils mais cela ne sert à rien puisqu'ils n'ont que très peu de pouvoir.
L'autonomie du système éducatif s'est en outre réduite depuis les années 60 par le développement de liens plus étroits entre les planifications économique et éducative. L'influence croissante de l'économie s'est exercée d'abord de façon centralisée, au travers des plans du Commissariat général du plan kesako?.
Le plan, c'est une sorte de document qui présente les grandes orientations économiques et sociales à venir. Il est réalisé par l'état en concertation avec les différents partenaires sociaux (syndicats, associations, etc...). Tu vois le lien ?
Actuellement, elle est moins dirigiste et plus localisée. Cela est particulièrement évident dans l'enseignement professionnel au sein duquel on tente d'ajuster la formation à l'emploi au niveau national : dans les commissions professionnelles consultatives, et aux niveaux régional et départemental, dans les bassins de la formation à l'emploi. Enfin, l'autonomie du champ éducatif se trouve également limitée par l'articulation des politiques d'éducation avec d'autres politiques sectorielles, comme par exemple celle de la ville (ça tu le disais aussi tout à l'heure.Mais en quoi est-ce un mal?)
Ben en fait, les villes ont plus ou moins de moyens et le budget consacré à la scolarité peut être très variable d'une ville à l'autre...
Un dernier préjugé très répandu concerne le fonctionnement de l'administartion de l'éducation nationale, souvent critiquée pour son haut degré de centralisation et son immobilisme bureaucratique. Il est vrai que, malgré la décentralisation, l'administration centrale conserve encore des compétences essentielles et des moyens divers d'influence sur les décisions locales. Par ailleurs, la "centrale" et plus encore les administrations locales peuvent apparaître comme le modèle le plus achevé de la bureaucratie à la française : omniprésence de la hiérarchie, haut degré de segmentation des directions, des services et des tâches, et forte standardisation des activités(j'comprends rien du tout là).
Tu t'en fous, c'est une description à la AVZ comme seule elle peut en faire...
Mais un certain nombre de changements apparaissent. Le découplage entre l'action de l'administration et le coeur de l'activité qu'elle est censée encadrer -c'est à dire l'action pédagogique dans les classes- semble diminuer. Le système tend, en fait, à "pédagogiser" la hierarchie administrative et à demander à la hiérarchie pédagogique d'intégrer les dimensions administratives et financières
je dois vraiment être bête ou c'est normal que j'y pige presque rien?[/quote]
Non, les sociologues ont la mauvaise habitude de faire des phrases complexes pour des trucs tout con, ça leur donne un air intelligent !!!
Bref, lis les remarques que je t'ai mise puis lâche ton texte un moment et reviens y plus tard à tête reposée.
Je vais faire mon sac, je pars à Troyes avec Juju et ne reviens que dimanche soir mais si t'as le moindre souci de compréhension, tu peux m'appeler sur mon portable et sinon, tu peux toujours envoyer un mail à AVZ pour qu'elle t'explicite ce qu'elle a voulu dire.
Voilà son adresse : agnes.vanzanten@sciences-po.fr
Bon courage,
Elo.
- Sab
- Sab'liées et Tite Grande Sab... ;-)
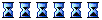
- Messages : 4646
- Enregistré le : 14 mars 2003, 01:00
- Localisation : planète lol
mes petits bonheurs de rien du tout:Lodie a écrit :J'espère que tu as des occupations plus passionantes ;-)
-prendre "la grammaire est une chanson douce" d'Eric Orsenna
-mes lunettes de star
-mon monoï de pétasse
-prendre le transat de ma mère
-à côté des fleurs qui sentent fort et entendre le bzz des bestioles qui butinent ces mêmes fleurs
-à proximité une canette de coca light
s'allonger pour lire au soleil
(prévoir du produit après soleil pour les brûlures)
- Elodie
- Modératrice trash

- Messages : 2605
- Enregistré le : 28 mars 2003, 01:00
- Localisation : Au boulot !
Pour répondre à ta question Sylvie, je suis assistante chargée d'études pour une mission de 15 mois (enfin maintenant il reste moins d'un an !). Je réalise une étude qualitative sur les politiques de vie étudiante des universités françaises. Là, j'ai eu 15 jours de vacances. J'avais ramené des dossiers à la maison mais je n'ai pas encore eu le courage de m'y mettre. Pourtant, va bien falloir puisque j'ai une synthèse à rendre à la mairie de Paris à la rentrée et une note à publier sur les sites internet des universités.
Quant à toi, ma Sabbou, tu as raison, faut profiter ! Moi, j'y arrive pas parce que cette nuit, je me suis disputée avec mon ours par téléphone, il est à 1000 km, et aujourd'hui, il bosse comme un malade pour sortir 1350 petits fours pour un mariage sans compter les entrées et les plats... Du coup, je glande à la maison devant l'athlétisme en m'interrompant de temps en temps pour faire du ménage.
Je vous fait des bises,
Elo.
Quant à toi, ma Sabbou, tu as raison, faut profiter ! Moi, j'y arrive pas parce que cette nuit, je me suis disputée avec mon ours par téléphone, il est à 1000 km, et aujourd'hui, il bosse comme un malade pour sortir 1350 petits fours pour un mariage sans compter les entrées et les plats... Du coup, je glande à la maison devant l'athlétisme en m'interrompant de temps en temps pour faire du ménage.
Je vous fait des bises,
Elo.